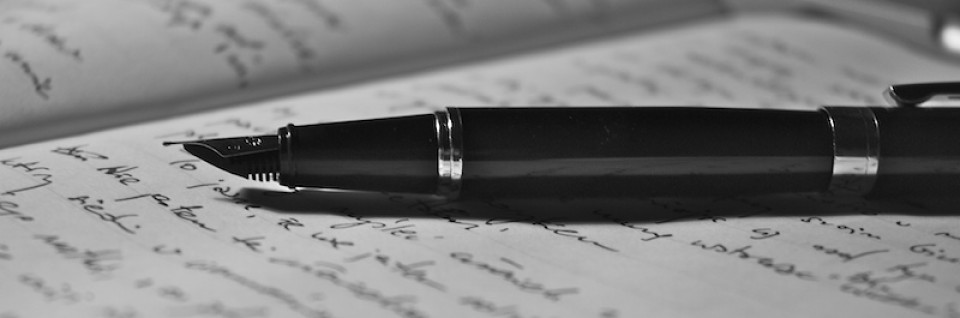(Illustration 1)
(Illustration 1)  (Illustration 2)
(Illustration 2)
On discute du poème Un Coup de dés (1897), car il est un des poèmes de Mallarmé réellement unique et célébré pour sa forme et son style originaux, tandis que Brise marine (1865) est un poème avec des rimes et des formes traditionnelles comme le sonnet (Sipe 367). Cela est évident par le fait que les rimes et les thèmes y sont plus facilement identifiables que dans Un Coup de dés.
Un Coup de dés est donc symbolique, non seulement pour son vocabulaire (par exemple : « jaillissements, » « enfouie, » « envahit, » ou « hantise ») (367) mais pour la position des mots qui contribuent aussi au sens du poème. On compare ces deux textes pour obtenir une compréhension de développement du style et de la forme que Mallarmé a produit. J’ai choisi un texte qui a été écrit au début de (Brise marine) et puis un texte qui a été écrit à la fin de sa carrière pour mieux voir le développement.
La pièce littéraire la plus originale chez Mallarmé est Un Coup de dés, qui n’a pas de schéma, strophes, ou structure consistante. Il a changé son style, car il était « fatigué de la monotonie qui entache obligatoirement et ennuyeusement la prosodie traditionnelle » (Walzer 234). Il a donc essayé de faire quelque chose de différent et non conformiste. Il a créé, dans le cas d’Un Coup de dés, autre chose qui « n’est ni prose, ni vers libre, mais une pensée poétique qui se distribue sur les pages et s’y soutient par le jeu des blancs et des caractères » (234). C’est-à-dire que le positionnement physique des mots ainsi que le contenu du poème contribuent au sens.
On interprète le poème d’une manière différente de chaque fois qu’on l’a lu (234).Mallarmé joue avec l’esprit, puisque le placement des mots eux-mêmes est tout aussi important que les mots, ce qui est la raison pour laquelle on interprétera le poème différemment à chaque lecture. Mallarmé remet en question la capacité de «l’esprit humain qui impose la cohérence … cela développe des explications à travers une lecture des signes dans la nature » (La Charité 157), mais il n’y a aucun moyen possible de trouver une réponse à la question de sens. De cette façon, beaucoup d’œuvres précédentes chez Mallarmé n’utilisent pas l’espace pour contribuer à la signification du poème, car c’était inhabituel.
En fin de compte, on peut dire que le Symbolisme joue un rôle clé dans ce poème pour l’effet, car « des fragments…demande un effort…pour arriver à déceler l’objectif ultime…: produire l’effet » (Granada 4). Les différences les plus marquantes entre ce poème et Brise marine est la question de l’espace, la taille et le placement, des mots qui contribuent au sens, l’interaction personnelle du lecteur avec le poème, ainsi que le fait que son état mental ait changé (132) à la fin se sa vie.
Dans Brise marine, Mallarmé insinue, par des métaphores de l’eau et un vocabulaire méticuleux, que le sentiment d’inspiration ainsi que la conviction de quelque chose manque dans sa vie. Il y a deux strophes, avec un schéma traditionnel : AABBCCDDEE/FFGG au lieu d’original. Le sentiment de manque est notamment évident dans le vers « mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots » (Mallarmé 14). On conclut donc, car il parle de ses émotions dans sa poésie, qu’il n’est pas satisfait de sa vie. Par conséquent, il n’est pas surprenant que son style ait radicalement changé au but de combler ce manque. Malgré cet effort, il semble peu probable qu’il ait réussi à atteindre cet objectif (Johnson).
Il y a aussi des ressemblances de thèmes dans ces deux poèmes, tels que « la mer, étale après l’orage mais encore blanche d’écume, et les nuages …qui… form[ent] le décor d[es] poème[s] » (Davies 180). Un Coup de dés « rattache les symboles auxquels est confiée la signification abstraite » (180-1) et en le faisant en compagnie de ces thèmes, Mallarmé « rattache au cycle baudelairien » (Hambly 20). Cependant, ces idées récurrentes sont restées avec Mallarmé, indépendamment de son évolution vers un poète symboliste. Il y a des aspects de son écriture qui restent dans sa poésie, mais sa progression pendant sa vie est notamment vue par la divergence du style et de la forme de ses deux poèmes.
Défilez vers le bas de la page pour trouver une liste des oeuvres de Mallarmé :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Stéphane_Mallarmé/131354
La bibliographie
- Davies, Gardner. Vers un explication rationnelle du coup de dés essai d’exégèse mallarméenne. Paris: Librarie José Corti, 1953. Imprimé.
- Granada, Gloria Melgarejo. Fragments et Obstacles: Mallarmé et le ‘génie’ du livre inachevé/poésie et dédoublement esthétique. 159. New York : l’édition de Peter Lang S.A., 2009. Imprimé.
- Illustrations 1 et 2. « Stéphane Mallarmé ». Pinterest. En Ligne. 29 septembre 2014.
- Hambly, Peter S. Mallarmé : devant ses contemporains 1875-1899. Australie du Sud : la presse de l’université d’Adelaide, 2011. En ligne. http://www.adelaide.edu.au/press/titles/mallarme/Mallarme_eBook.pdf
- Johnson, Barbara. “Translator’s Note to Stéphane Mallarmé : divagations”. Trans. Johnson, Cambridge. Massachusetts: la presse de l’université de Harvard, 2007. Google Book Search. En ligne. 29 septembre, 2014.
- Mallarmé, Stéphane. The Poems : a bilingual edition translated. New York : Penguin Books, 1977. Imprimé.
- « Stéphane Mallarmé.» Encyclopédie Larousse en ligne. Pas d’auteur, pas de date. En ligne. 29 septembre 2014.
- Sipe, Daniel. “Mallarmé et l’écriture du corps.” Nineteenth-Century French Studies 2 (2007): 367-383. La bibliographie internationale de MLA. En ligne. 30 septembre 2014.
- Walzer, Pierre-Olivier. Essai sur Stéphane Mallarmé : bibliographie, portraits, fac-similés. Paris : P. Seghers, 1963. Imprimé.