(Illustration 1)
La relation entre Mallarmé et Baudelaire est un peu complexe, car Baudelaire l’a inspiré, mais Mallarmé cherchait naturellement quelque chose de différent de ses idoles, qui le séparaient d’eux. Cela ne veut pas dire, cependant, que Mallarmé et Baudelaire ne participent pas dans une relation importante. Baudelaire était l’une des idoles fondamentales dans la vie de Mallarmé et il a commencé sa carrière influencée et inspirée fortement par Baudelaire.
Bien qu’il ait changé son style et a dépassé ses idoles, sa carrière n’a pas commencé de cette façon ; Mallarmé a commencé sa carrière comme élève de Baudelaire « avec pastiches de Fleurs du mal » (de Man 192) et il a trouvé et a montré beaucoup de sentiments « baudelairiens » (Austin 28) au début de sa carrière (notamment vu dans Parnasse). Par exemple, Mallarmé a conservé un sentiment « d’un spleen, du rejet violent d’une réalité jugée laide et imparfaite» (Austin 24) et aussi « le sentiment qu’il existe un monde différent, fait d’harmonie et d’unité retrouvée » (Larousse : Stéphane Mallarmé, Michaud 1953, 78) chez Baudelaire. Mallarmé, comme Baudelaire, veut que le langage « parle pour [lui]-même… ces deux hommes restent conscient que l’écriture, en quelque sorte, doit être animée par la voix humaine » (Abbott 113). Mallarmé a adopté la notion de résonance de la voix qui vient de Baudelaire ; c’est donc évident que leur relation « provient de résonances établies entre leurs poèmes » (102). Plus spécifiquement, la façon dont les deux poètes utilisent la voix dans la poésie « offre une vue différente sur la perception acoustique » (224). En outre, le sentiment du « spleen est reprise par Mallarmé dans Las de l’amer repos » (Austin 28), et aussi dans A celle qui est trop gaie (28). En continuant cette idée des poèmes qui sont influencés par Baudelaire, le poème qui est « le plus baudelairien » (28) est Angoisse « où l’amour devient la recherche de l’oubli » (29) et ses idées « sont au cœur de la théorie et de la pratique baudelairienne des Correspondances » (23).
Tout au long de sa carrière, le style de Mallarmé s’est éloigné de plus en plus de celui de Baudelaire, mais Mallarmé n’a jamais oublié les aspects de Baudelaire mentionnés dessus, car certains éléments de son écriture sont encore répandus dans le travail de Mallarmé. Mallarmé a adapté cette nouvelle mentalité qui le sépare de ses idoles (Cohn 109), le faisant tout autant, sinon plus, impressionnant qu’eux.
La bibliographie
- Abbott, Helen. “Between Baudelaire and Mallarmé.” Voice, Conversation and Music Octobre 2009: 22-29. Ashgate Publishing Press. En Ligne. 8 octobre 2014.
- Austin, Lloyd James. Essais sur Mallarmé. Ed. Malcolm Bowie. Manchester: la presse de l’université de Manchester, 1995. Imprimé.
- Cohn, Robert Greer. Un Coup de dés de Mallarmé: an exegesis. New York: la presse d’AMS, 1980, c. 1949. Imprimé.
- Illustration 1 « Stéphane Mallarmé ». Pinterest. En Ligne. 29 septembre 2014.
- de Man, Paul. The Post- Romantic Predicament. Ed. Martin McQuillin. Édimbourg: La presse de l’université d’Édimbourg, 2012. Imprimé.
- Michaud, Guy. Mallarmé : l’homme et l’œuvre. Paris : Hatier-Boivin, 1953. Imprimé.
- « Stéphane Mallarmé.» Encyclopédie Larousse en ligne. Pas d’auteur, pas de date. En ligne. 29 septembre 2014.
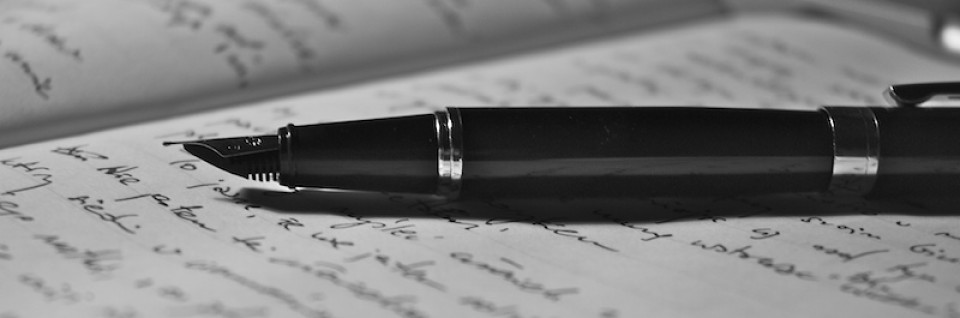






 (Illustration 1)
(Illustration 1)