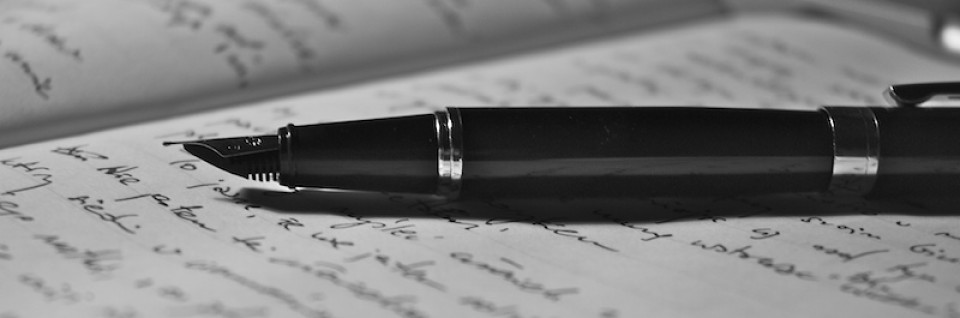(Illustration 1)
(Illustration 1)
Étienne Mallarmé, mieux connu par le nom Stéphane Mallarmé, est né à Paris le 18 mars, 1842. Il reste, de nos jours, l’une de grandes figures de la littérature française et il a été l’inspirateur du mouvement symboliste » (Études Littéraire : Mallarmé). Avant de discuter de son influence mondiale, nous devons d’abord examiner les événements principaux de sa carrière, sa vie et ses études.
Les parents de Mallarmé, Élizabeth Félicie Desmoulins et Numa Mallarmé, se sont mariés en 1841. Ils étaient « fonctionnaires » (Musée de Mallarmé par.1) : son père travaillait en tant que « le sous-chef à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines » (Mondor 186). Le 25 mars 1844, Maria, sa soeur est née. En 1852 Stéphane a commencé ses études littéraires et linguistiques « dans une pension religieuse à Auteuil » (186).
La mère de Mallarmé est décédée en 1857, et le 31 août de la même année, Stéphane a pris un poste « comme pensionnaire en 4e au lycée de Sens » (186) où il a été influé par « Victor Hugo, Théophile Gautier, puis Charles Baudelaire » (Musée par.1). Ces auteurs ont inspiré ses œuvres, et leur influence est restée avec lui tout au long de sa carrière et « il a exercé sur [leur mémoire] non négligeable » (Études). Suite à l’influence de leur style, il a essayé de capturer « une réalité supérieure au monde réel » (Études) dans son travail. C’est au Lycée qu’il enseignait comment parler l’anglais couramment.
En 1860, Mallarmé a obtenu son baccalauréat (186) et « a [été] placé…par son père chez le receveur de l’enregistrement de Sens » (Larousse). Avant d’écrire de la poésie, Mallarmé était un journaliste et a traduit de nombreuses oeuvres d’Edgar Allan Poe et d’autres auteurs notables. En 1862, il a publié les poèmes suivants : le Guignon, Le Sonneur, Le Placet et l’essai Hérésies artistique ainsi que L’art pour tous. La publication des œuvres dans un journal est le début de sa carrière littéraire, laquelle s’est développée lentement, mais vers la fin de sa vie, elle a reçu beaucoup de reconnaissance pour son originalité et son innovation de syntaxe et de forme dans des textes tels que Un coup de dés. Ensuite, il a tragiquement perdu son père, qui est mort le 12 avril 1863. Au cours de la même année, Stéphane s’est marié avec Marie Gerhard. Peu après, le 19 novembre 1864 sa femme a donné naissance à leur fille, Géneviève. De plus, « il obtient son certificat d’aptitude à l’enseignement de cette langue et devient professeur » (Musée) et « d’anglais en province (Tournon, 1863-65 ; Besançon 1866 ; Avignon, 1867) » (Larousse). Pendant ce temps, il a écrit intensément et fanatiquement ; c’est-à-dire que « Mallarmé se trouv[e] de nouveau pris dans l’activité de la vie littéraire à laquelle il participe de plus en plus » (Larousse).
En 1870, l’auteur retourne à Paris où il « est de nouveaux nommé professeur au lycée Fontanes » (Larousse). Le 18 juillet 1871, son fils Anatole est né ; mais celui-ci tombe malade pendant son enfance et est décédé en 1879, à l’âge de huit ans. Suivant cet événement et tous les décès dans sa famille, Mallarmé est devenu mélancolique, voilà son inspiration du poème Pour un tombeau d’Anatole (Poetry in Translation 2009). En 1877, il a publié Les Mots anglais et, en 1880, les Dieux antiques.
En fait, en 1880 et jusqu’à sa mort, il a arrangé “Salons,” un rassemblement chaque mardi soir avec des poètes et des écrivains bien connus de cette époque, pour discuter de sujets intellectuels. Ce groupe célèbre est devenu connu sous le nom de « les Mardis ». Plusieurs figures notables étaient dans ce groupe, et ils ont assisté à l’événement, chaque mardi soir à la maison chez Mallarmé (Larousse).
En 1882 « la rencontre avec Méry Laurent….devient sa muse : il écrira pour elle, entre autres, de Vers de circonstances » (Larousse). En 1884, Paul Verlaine et Joris-Karl Huysmans attirent leur attention sur Mallarmé et sa capacité d’écrire, tandis qu’il a publié son poème Prose pour des Esseintes dans La Revue indépendante (Larousse). Finalement, en 1887, il a publié une édition de ses poésies, et l’année suivante, il a traduit « les poèmes de Poe et l’essai du peintre James Whistler, Ten O’Clock » (Larousse).
Vers la fin de sa vie, sa santé a détérioré, et il a décidé d’aller vivre à Valvins et « d’élaborer enfin le Livre » (Larousse). C’est là, à Valvins qu’il a écrit plusieurs de ses œuvres iconiques, bien que quelques d’entre elles qui soient restées inachevées. Le 9 septembre 1898, Mallarmé est décédé d’un « spasme du larynx » (Larousse).
La bibliographie
- Mondor, Henri. Autres précisions sur Mallarmé et inédits. Paris : Gallimard, 1961. Imprimé.
- Illustration 1. « Étienne, dit Stéphane Mallarmé.» Encyclopédie Larousse en ligne. Pas de photographe, pas de date. En ligne. 29 septembre 2014.
- « Étienne, dit Stéphane Mallarmé : la biographie.» Encyclopédie Larousse en ligne. Pas d’auteur, pas de date. En ligne. 29 septembre 2014.
- « Stéphane Mallarmé : la biographie.» Musée Stéphane Mallarmé : dans l’intimité du poète. Pas d’auteur, pas de date. En ligne. 5 octobre 2014.
- «Stéphane Mallarmé : la biographie.» Études Littéraire. Pas d’auteur, pas de date. En ligne. 5 octobre 2014.
- « Stéphane Mallarmé.» The Poetry Foundation. En ligne. 29 septembre 2014