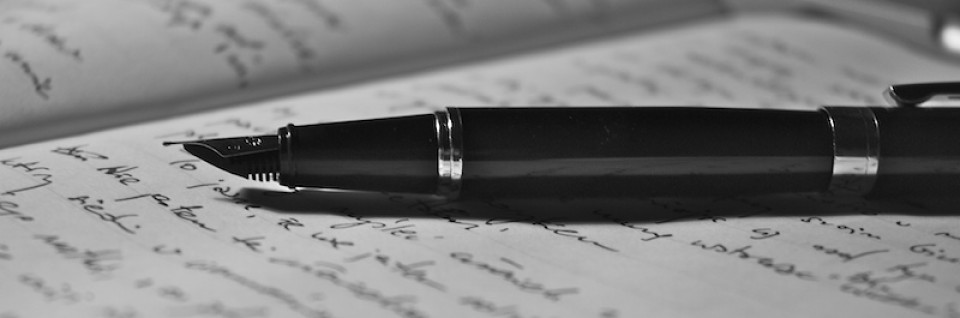(Illustration 1)
Stéphane Mallarmé est l’un « des maîtres » (Cohn 3) et l’un des quatre plus grands poètes du Symbolisme de la seconde moitié du XIXe siècle (Poetry Foundation). Il met l’accent sur la forme, le sens des mots peu conventionnels, et en ce faisant, il enseigne des leçons d’écriture qui impactent d’autres domaines, notamment à toute la poésie du 21e siècle (Michaud 165, 1965).
Il a aussi écrit des poèmes traditionnels au début de sa carrière, et il est l’un des poètes qui « tâch[e] [toujours] à édifier enfin la Poésie, forme tard venue de l’Art » (Wyzea 20). Par exemple, on voit ses deux formes opposées dans Brise marine (1865) et Un Coup de dés (1897). Les poèmes Hérodiade (1887) et L’Après-midi d’un faune (1876) discutent de la complexité de la vie et des émotions et sont écrits dans une forme peu conventionnelle (Paxton 25). Par sa poésie, on conclut que Mallarmé a exprimé qu’il s’est éloigné de ses émotions. Il préfère «le silence réprobateur…il prenait encore soin de noyer les vertus cinglantes de son ironie dans la douceur du ton » (Verdin 14). Mallarmé maintient toujours un ton doux et n’exprime jamais explicitement l’émotion.
On voit donc « une indication claire et constante de développement » (56) dans son style et préférence d’écriture et « sa mission de l’art devient l’expression et la prise de conscience » (Delfel 36). Vers la fin de sa carrière, son écriture est
« composé avec nouvelles idées de style et de syntaxe au but de produire un type de prose tellement unique, intemporelle et des textes avec la densité terrifiante » (Paxton 11). Il a donc découvert son style indépendant, qui met l’accent sur la forme et la densité des images, notamment vue dans Hérodiade et L’Après-midi d’un faune.
Curieusement, Mallarmé préfère « les images simples…pour évoquer au décor» (Davies 180), et les mots fournissent aussi un sens profond de l’image, et d’être « plus précis » (180) dans ses poèmes. On le voit dans Un Coup de dés où il crée « une quarantaine d’illustrations, choisies avec délicatesse exemplaire » (Clive 262) en formant les images de la mer, des nuages et de l’étale après l’orage (180). Par conséquence, il développe un style détaillé, simple et aussi complexe à la pointe de “l’incompréhensibilité de temps en temps” (180).
Il admirait la poésie de Charles Baudelaire et d’Edgar Allan Poe ainsi que celle de Victor Hugo et d’Arthur Rimbaud. Baudelaire a influencé Mallarmé comme source d’inspiration pour développer « le schéma …qui est toujours le même » (Delfel 36), et aussi pour développer les thèmes tels que l’idéal, la beauté, le mystère tout en maintenant la clarté (Oueslati 168-9), et à adopter l’obscurité dans sa poésie. Presque exclusivement, durant son adolescence (Cohn 109), Mallarmé a écrit de la littérature plutôt romantique que symbolique, car il a omit le sentiment d’un monde idéal (New World Encyclopedia), intellectuel et philosophique. Avant qu’il ait quitté Paris pour l’Angleterre, son écriture reflétait Baudelaire en contexte et en style (New World).
L’influence de Poe est reflétée dans Rationale of Verse, car, comme lui, il « utilise les grappes » (109) pour être audacieux, complexe et abstrait. Mallarmé a tenté d’écrire sur toutes les relations possibles entre tout ce qui existe (Walzer, 184-5).
Au début de sa carrière littéraire jusqu’à près de sa fin, le style de Mallarmé manquait d’originalité et de distinction, car il tendait à copier le style d’autres auteurs plutôt que d’inventer le sien (notamment Charles Baudelaire). Mais à la longue, Mallarmé est devenu fatigué de cette répétition, et a commencé à prendre un cours différent de tout ce qui est venu avant. C’est dû à ces changements dans son approche que son style est devenu noté pour son indépendance ; ce qui est remarquable, car il pense que « la poésie est l’art de l’excellence, art qui se manifeste aussi bien par un jeu de la pensée … pour illustrer la complexité d’[un] jeu…chaque fragment ou morceau de texte est appliqué » (Granada 12).
Son enfance triste aussi bien que de nombreux décès dans sa famille ont contribué à la raison pour laquelle il pense que « la vie n’était rien que ténèbres et vide » (New World), cette perspective est devenue l’une de ses muses. Par exemple, il a écrit Pour un tombeau d’Anatole, La tombe d’Edgar Allan Poe, et La tombe de Charles Baudelaire au but de rendre hommage aux décès de ses amis et de sa famille. Il a aussi écrit au sujet de la nature, des étoiles, du ciel, du corps et de la virginité : tous des symboles de l’esprit érotique humaine (New World). De plus, il a toujours eu du mal à trouver sa capacité à croire en quelque chose de divin ; rejetant son élevage catholique, il se débattait à la place avec l’idée en suggérant que c’est l’idéal sexuel qui se développe dans l’esprit (Michaud 137, Oueslati 168). Rosemary Lloyd, spécialiste de Mallarmé, conclut qu’il a aussi créé des symboles représentant les amitiés dans sa vie (Lloyd 167). Mallarmé était inspiré par ses relations avec ses amis belges, notamment dans Remémoration d’amis belges. Mallarmé est devenu un fondateur du Symbolisme, par sa volonté de créer un style nouveau. Jusqu’à ce jour, son style est admiré et lu par des millions à travers le monde entier et demeure « un mythe, de la perfection … [qu’]il … a offert au monde… l’un des morceaux les plus indéchiffrables d’écriture » (Cohn 3) dans la littérature.
La bibliographie
- Cohn, Robert Greer. Un Coup de dés de Mallarmé: an exegesis. New York: la presse d’AMS, 1980, c. 1949. Imprimé.
- Clive, Scott. “Stéphane Mallarmé (review).” French Studies: A Quarterly Review 2 (2011): 262-262. Project MUSE. En ligne. 30 septembre 2014. http://muse.jhu.edu/
- Davies, Gardner. Vers un explication rationnelle du coup de dés essai d’exégèse mallarméenne. Paris: Librarie José Corti, 1953. Imprimé.
- Delfel, Guy. L’esthétique de Stéphane Mallarmé. Paris : Flammarion, 1951. Imprimé.
- Granada, Gloria Melgarejo. Fragments et Obstacles: Mallarmé et le ‘génie’ du livre inachevé/poésie et dédoublement esthétique. New York : l’édition de Peter Lang S.A., 2009. Imprimé.
- Illustration 1. « Stéphane Mallarmé ». Wikipédia.fr, le 24 octobre 2014 à 15h30. En Ligne. 29 septembre 2014.
- Lloyd, Rosemary. The Poet and His Circle. New York: la presse de l’université de Cornell, 1999. Imprimé.
- Michaud, Guy. Mallarmé. New York: la presse de l’université de New York, 1965. Imprimé.
- Oueslati, Salah. Le lecteur dans les poésies de Stéphane Mallarmé. Grand Place: Bruylant-Academia s.a., 2009. Imprimé.
- Paxton, Norman. The Development of Mallarmé’s Prose Style. Genève: Librarie Dros S.A., 1968. Imprimé.
- « Stéphane Mallarmé.» The Poetry Foundation. En ligne. 29 septembre 2014.
- « Stéphane Mallarmé.» The New World Encyclopedia. Encyclopédie. Pas d’éditeur. 11 septembre 2014. En ligne. 29 septembre 2014.
- Verdin, Simonne. Stéphane Mallarmé: Le presque contradictoire précède d’une étude de variantes. Paris: A.G. Nizet, 1975.
- Walzer, Pierre-Olivier. Essai sur Stéphane Mallarmé : bibliographie, portraits, fac-similés. Paris : P. Seghers, 1963. Imprimé.
- Wyzea, Teodor de. Notes sur Mallarmé.Paris : Publications de la vogue, 1886. En Ligne. http://ezproxy.library.uvic.ca/login?url=http://www.archive.org/details/mallarmnotes00wyze/